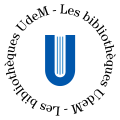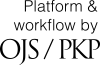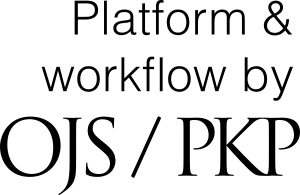Corporéité et Apprentissage
Pour une pédagogie au croisement de la philosophie, de la danse et des études féministes
DOI :
https://doi.org/10.7202/1119390arMots-clés :
corporéitié, agentivité, danse, pédagogies incarnées et féministes, cognition incarnéeRésumé
Dans cet article, nous souhaitons réfléchir à ce que serait une pédagogie incarnée dans l’enseignement philosophique et universitaire. Nous souhaitons décloisonner la compréhension commune de l’enseignement philosophique, dans laquelle le corps n’est pas ou peu engagné, à partir d’une pédagogie fondée sur l’expression du corps telle qu’elle est développée par les arts vivants. Pour ce faire, croiser les apports de champs disciplinaires variés tels que ceux de la philosophie, de la danse, de l’éducation somatique mais aussi des études féministes nous parait particulièrement opportun. La philosophie de l'Antiquité accordait une place importante au corps dans l'éducation à travers l'« art choral » qui comprenait notamment la danse (Platon, Les Lois, II 673d ; VII 795e, trad. L. Brisson et J.F. Pradeau). Aujourd'hui, si le corps est une ressource pédagogique reconnue (Duval et al. 2022, p. 3-4-5), son utilisation reste limitée à l'Université et alimente des rapports de domination par négation des vécus corporels. Tel que l'explique bell hooks, nier le corps alimente le mythe d'une classe neutre permettant de normaliser certains comportements associés aux classes sociales dominantes (hooks, 1994). Or, cette normalisation restreint l'apprentissage des étudiant-es venant de groupes sociaux non-dominants. En réponse à ce problème, nous nous intéresserons aux enjeux pédagogiques, mais aussi épistémiques et politiques qu’induit la prise en compte de la corporéité dans l’enseignement. Il nous semble crucial de les identifier à travers une démarche interdisciplinaire afin de rendre compte de la complexité et de la richesse de la corporéité, au croisement de la philosophie, de la danse et des sciences de l’éducation.
Pour répondre à la question, comment mettre la corporéité au centre de l'apprentissage, en tant que ressource pédagogique et lieu de savoir ?, nous clarifierons d’abord l’enjeu pédagogique en précisant ce qu’est un apprentissage « par corps ». Dans un deuxième temps, nous aborderons l’enjeu épistémique lié au « savoir expérientiel » en interrogeant les relations entre action, perception et cognition, mais aussi la dimension affective du savoir. Enfin, nous explorerons l’enjeu politique lié à la prise en compte de la corporéité dans l’apprentissage en montrant, grâce aux concepts d’autorité somatique et d’agentivité épistémique incarnée, que la conscience des sensations corporelles et de la relation du corps avec son environnement est susceptible d’augmenter notre pouvoir d’agir.
Publié
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
© Camille Zimmermann, Héloïse Husquinet, Mathilde Cambron-Goulet, Nicole Harbonnier 2025

Cette œuvre est sous licence Creative Commons Attribution - Pas de Modification 4.0 International.
Les auteur.e.s conservent le droit d'auteur et accordent à la revue Philosophiques le droit de première publication, l'œuvre étant simultanément placée sous une licence Creative Commons Attribution License (CC BY ND 4.0) qui permet à d'autres de partager l'œuvre, sans modifications, avec une reconnaissance de la paternité de l'œuvre et de sa publication initiale dans cette revue.